
La traversée Jakarta – Medan
Vous est-il déjà arrivé de vous dire : « Je suis libre ! Libre de faire ce que je veux ; d’aller où je veux ; sans contrainte, sans compromis. Je suis mes envies ! »
Ce fut mon cas en quittant Yogyakarta.
Je ne peux me souvenir de la dernière fois où je me suis sentie aussi libre de me laisser porter par le vent.
Face à autant de liberté, que faire ? Ce fut la seule question. Tous les possibles étaient ouverts. Je pouvais poursuivre à Java. Aller à Sumatra. Me rendre dans les îles Sulawesi ou Komodo pour retrouver la mer et la plongée… Que de choix, tous envisageables.
Je décide de prendre le temps. Pas d’avion, je voyage à l’ancienne. Après moult tergiversations, je choisis d’aller à Sumatra. Les îles Sulawesi et Komodo attendront le printemps. Je n’ai pas besoin de renoncer.
Mon périple vers Medan, au Nord de Sumatra, commence par un train de nuit entre Yogya et Jakarta. Puis, je vais au bureau de la compagnie de ferry. Une file de vingt-cinq personnes est devant moi. On me propose de ne pas attendre. Je suis une occidentale. Probablement la seule qu’ils voient depuis longtemps. Je refuse. Je ne cherche pas les traitements de faveur. J’attends comme tout le monde. Je suis de nouveau au centre des regards. Je m’y habitue. Les personnes parlant anglais, m’accostent. Nous échangeons sur les questions de base : « Qui suis-je » ? « Où vais-je », etc… Ils sont attentifs, surpris de mon voyage en ferry. Ils me demandent si je me rends bien compte que le voyage durera trois jours. Ils me disent tous que l’avion serait plus rapide. Alors j’explique que je prends mon temps. On ne prend jamais le temps quand on voyage. On va d’un point A à un point B selon un planning optimisé pour en voir le plus possible. Ce n’est pas mon besoin. Je souhaite juste profiter de chaque instant, de chaque rencontre, de chaque découverte.
Avant de prendre mon ticket, j’avais regardé les images des différentes « classes » sur Google. Je souhaite faire comme tout le monde. J’avoue cependant avoir besoin, parfois, d’un certain standard de confort, notamment après l’épisode « Capsule ». Je choisis donc la première classe.
Une fois mon billet en poche, je me balade dans Jakarta. C’est une grande ville avec tous ses attributs : de hauts immeubles, une circulation dense, des centres commerciaux, des marques américaines et européennes. Je m’éloigne de cette fourmilière grouillante pour me retrouver dans le quartier de Batavia. C’est aujourd’hui le quartier chinois. Il était autrefois le symbole de la conquête néerlandaise et du commerce d’épices. Je me perds dans le dédale des ruelles pour arriver au Café Batavia. Café chic à l’architecture d’époque, il abritait autrefois le siège de l’administration de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales. Le décor est somptueux : mobilier en bois d’époque, ventilateurs au plafond, photos de stars des années 30. Je suis transportée dans les années coloniales sur un air de Jazz. Chaque note résonne et m’emporte dans un voyage hors du temps.
Ce n’est que le début de mon voyage temporel. En arrivant, à 22h, sur le quai pour prendre mon ferry, je vois les locaux qui patientent. Ils sont chargés de caisses, de cartons, de valises hors d’usage. Puis, je monte dans le bateau. Je traverse tout d’abord les classes économiques. Ce sont en fait des lits superposés à perte de vue installés pratiquement en fond de cale. Je suis projetée au XIXème siècle. Le capitaine m’aperçoit. Il vient vers moi pour m’extirper de la « populace » et m’amener vers les beaux quartiers. J’ai l’impression d’être une bourgeoise qui doit être évacuée des quartiers malfamés. Tout d’un coup, le film « Titanic » se rappelle à moi. Puis la série, « la croisière s’amuse ». Je m’imagine dîner à la table du capitaine Stubing en invitée de marque.
Je rejoins ma cabine. La première classe correspond à nos catégories économiques. Je me félicite de l’avoir choisie. De toute évidence et en toute honnêteté, je ne me serais pas vu vivre trois jours dans un dortoir de cent lits avec une promiscuité ne permettant aucune intimité. Je partage ma chambre avec quelques cafards. Je les regarde. Ce sera eux ou moi. Je gagne à grand coup de savates. Je m’installe et monte sur le pont pour assister à notre départ.
Les trois jours s’écoulent avec lenteur au gré des levers, des couchers de soleil et du chant du muezzin cinq fois par jours. Une chose est certaine : je n’ai raté aucun lever de soleil grâce à l’appel à la prière. Réglé comme du papier à musique à 4h32, tous les matins, diffusé par le haut-parleur de ma chambre. Impossible de l’éteindre. Impossible de mettre une sourdine.
Alors, je me lève pour admirer le lever du soleil. Je suis sur le pont. Je regarde l’horizon comme tous les autochtones. Au fur et à mesure, nous sortons de la nuit. Les premiers rayons, sur cette mer calme, nous éclairent. Les reflets scintillants s’expriment sur nos visages. La chaleur du soleil se fait de plus en plus sentir.
A cette occasion, j’échange avec les locaux, toujours autour des mêmes questions. A force de voir leurs regards ahuris quand je dis que je voyage seule, je finis par m’inventer un mari.
Laissez-moi, vous le présenter.
Il s’appelle Steeve, c’est le prénom de mon grand-père. Steeve est un songe. Il est le héros de mon imagination. Nous sommes différents et complémentaires. Il n’est en rien un stéréotype papier glacé. Il est juste lui. C’est parfait ainsi. Cela dit pour être convaincante, il faut être concrète. Alors, Steeve a tous les traits des hommes de ma vie. Il est grand et fort comme mon père. Il est ingénieur et protecteur comme mon frère. Il est musicien comme mon Petit Chat. Il est photographe et voyageur. Il n’a pas pu me rejoindre car il travaille en France. Mais nous nous retrouvons dans quelques jours à Singapour. Pour parfaire mon histoire, je mets à mon annulaire, la bague offerte par de fabuleux pioupious. Je suis parée. Mes interlocuteurs sont rassurés. Parfois, ils sont déçus aussi.
Nous discutons de la famille, du couple, des enfants. Ils sont étonnés de ma mentalité française : pas de mariage « obligatoire », des enfants à plus de trente ans, être autonome et indépendante, être libre de mes choix et ne pas demander l’autorisation à mon mari pour toute dépense ou envie. Je les achève généralement quand je leur dis que Steeve est heureux pour moi. Il est fier que je voyage seule. Il a toute confiance en moi et en mes choix.
Au gré de mes discussions, je rencontre Ady. Il est designer, marié et père de trois garçons. Il est intéressé par mon voyage, par nos similarités culturelles et nos différences. Je parle de tout avec lui : d’Europe, de liberté culturelle, de religion, de travail. Nous sommes d’accord sur l’essentiel et les valeurs humaines. Sa vision du monde est très européenne. Notre perception partagée de la vie est frappante en comparaison avec tous les autres échanges. Puis, il me raconte son rêve : « ouvrir un coffee shop à Batam en 2020 ». Il me questionne sur nos standards, la recette des viennoiseries et des tartes. Il connait déjà tout sur le café. Nous prenons rendez-vous en 2020 pour l’inauguration de son café et en 2025 en France. Qui sait si cela sera réel ou pas. Sur l’instant, c’est une promesse donnée.
Au ronronnement de mon ferry, des trois repas par jour à base de riz et des échanges, le temps semble s’étirer. Chaque action semble durer infiniment. Il s’agit juste de prendre le temps de respirer et de profiter du moment.
D’ailleurs, le dernier matin lors du lever de soleil, ils mettent des musiques rock. Est-ce à mon attention ? Qui sait ? L’une des chansons est « It’s my life » de Bon Jovi. Je trouve la synchronisation parfaite. Le refrain « It’s my life, It’s now or never, I ain’t gonna live forever, I just want to live while I’m alive » reflète le tréfonds de mes pensées et de mes sentiments. J’écoute cette chanson comme si je ne l’avais jamais entendue. Elle prend tout d’un coup un sens nouveau. Est-ce un signe ? Peut-être. Seul l’avenir me le dira.
Avant d’arriver à Medan, Ady me déconseille vivement d’y séjourner. C’est une grande ville risquée pour une touriste voyageant seule. Il m’informe aussi qu’il n’y a pas grand-chose à faire sachant que c’est une ville de transit. Il me propose de me faire sortir du port et de me mettre dans un bus pour Banda Aceh. C’est sa ville. Il m’en parle avec de la lumière dans les yeux. Je décide de le suivre.
Le ferry accosté, Ady et moi débarquons ensemble. Nous sommes en proie avec un nuée d’hommes qui nous alpaguent pour prendre leur taxi. Les sollicitations viennent de toute part. C’est oppressant. Je sers mon petit sac contre moi et j’avance. Je ne m’arrête pas. Je suis Ady. Après cinq minutes dans cette foule de sangsues, Ady m’indique un minibus.
Serrés à quinze, nous parcourons dans une chaleur étouffante les quelques kilomètres qui nous séparent de la gare routière. Ady s’esclaffe. Il me dit : « Tu voulais du local ! en voilà »






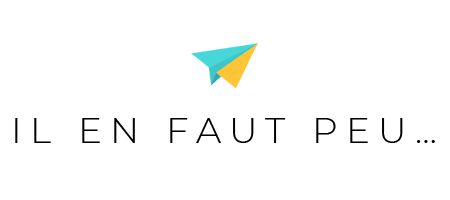









































4 commentaires
Nounours
Super article ! Bravo Amiguette.
Gros bisous,
B.
baloo
Merci ! 😘
S.
DUBOIS
Quelle émotion à la lecture de ton témoignage ! Merci à toi et nous ne pouvons imaginer à travers ton témoignage la chance que nous avons d’être née en France. Bises
stephane
Tous les hommes de ta vie seront toujours avec toi comme tu le sera toujours pour eux. Steeve a réellement beaucoup de chance de t’avoir.