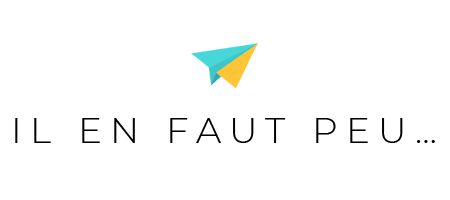Histoire d’une chute : cicatriser
J’ouvre les paupières légèrement. Je suis éblouie par la lumière. Tout est blanc, flou, parfois des taches de couleurs. Quelles sont ces formes qui s’agitent autour de moi ? Un hurlement inhumain résonne longtemps. Ma conscience émerge doucement. C’est moi qui beugle comme un cochon qu’on égorge. Et pour cause, une douleur brutale, froide, dévastatrice m’enveloppe tout entière. Cette torture est totalement insupportable. J’entends que l’on me parle, mais je ne comprends pas. Je sens un linge humide sur mon front. Je perçois l’eau qui ruisselle. Une main empoigne la mienne et je continue à crier à pleins poumons. Les seules millisecondes de répit sont celles où je reprends ma respiration. Mes yeux sont baignés de larmes qui coulent à gros bouillons. Puis, je crois saisir que l’on me demande en anglais mon niveau de douleur de 1 à 10. « Un milliard, connard ! » Ai-je vraiment répondu ça ? Tout d’un coup, je suis léthargique, apathique. En une fraction de seconde, les sons, les couleurs semblent s’éloigner puis disparaitre.
Lorsque je me réveille quelque temps plus tard, ce n’est plus blanc, mais beige, un ton chaud réconfortant. Je suis dans une chambre. Tout est calme. Je reprends doucement mes esprits. Je sais qui je suis, où je suis et ce que je fais là. J’ai pourtant l’impression que mon corps ne forme qu’un bloc solide. Je ne ressens rien. Alors lentement, en commençant par la droite, j’essaie de bouger mes doigts puis ma main, l’avant-bras et le coude. Je ne veux pas risquer de faire des mouvements d’épaule, car je crains les conséquences pour mon dos. J’exécute ensuite les mêmes gestes à gauche. Je suis soulagée, le haut du corps répond à mes sollicitations. Maintenant, en me limitant aux pieds, je suis aux aguets pour vérifier que ces derniers réagissent bien. C’est le cas ! Seconde bonne nouvelle. La première étant que j’ai survécu à l’anesthésie générale et à l’opération.
Comme je suis branchée à de nombreux moniteurs, une infirmière vient rapidement à mon chevet. Ses gestes sont doux, bienveillants. Elle a la grâce d’une danseuse étoile. Tout en elle est soigné, raffiné, beau : ses yeux marron souriants, ses cheveux couleur de jais attachés avec beaucoup d’élégance, ses mains fines… Avec une délicatesse infinie, elle me parle paisiblement. Elle me pose quelques questions de base (mon nom, ma date de naissance…). Puis, elle vérifie mes constantes, certains réflexes et m’informe que mon chirurgien, le Dr S., va venir me voir dans quelques instants pour me débriefer.
Comme j’ai soif, je lui demande de m’apporter de l’eau. Au moment où elle redresse légèrement et lentement le dossier de mon lit, une douleur fulgurante survient. Je hurle ! Elle me remet immédiatement en position horizontale. Aussi, ne pouvant incliner le buste, je ne peux pas boire par moi-même. Avec une attention infinie, elle me donne une paille et tient la bouteille. Avec son autre main, elle serre la mienne puis, telle une mère protectrice, me caresse les cheveux afin de me réconforter.
Cependant, alertée par ma réaction, elle me demande de lever les hanches. Sans succès. Je saisis en cette fraction de seconde que je ne vais pas pouvoir sortir de mon lit, ni me tenir debout, assise ou quoi que ce soit d’autre… Au même moment, elle se rapproche de moi et m’explique calmement qu’au regard de la situation, elle va me poser une sonde.
Et là, c’est la descente aux enfers. Certes, je ne suis pas paralysée. Mais pour quelque temps (à compter en heures ? En jours ?), je suis totalement impotente. On m’a dit qu’à la sortie de l’hôpital, je marcherais. On ne m’a jamais avertie que je me sentirais comme une infirme à mon réveil !
C’est à ce moment-là que le Dr S. arrive. Une fois de plus, il me voit en larmes, telle une épave. Avec sa bienveillance habituelle, ses gestes « paternels », on échange brièvement sur l’opération, mon niveau de douleur (insupportable quand je ne suis pas sous morphine), mon traitement, mon manque de mobilité. Il m’assure que tout s’est bien passé. Cela arrive parfois que le patient rencontre des difficultés après une telle intervention. Cela peut durer quelques jours. Il est cependant confiant, tout ceci est normal. Il me garantit que je vais être bien entourée par les infirmières, les aides-soignantes, les kinésithérapeutes et que, sous peu, tout rentrera dans l’ordre. Ce n’est qu’une question de temps. J’acquiesce en souriant faiblement, mais j’enrage intérieurement. Ça veut dire quoi du temps ? Combien ?
Ma souffrance étant pour l’instant maitrisable, je demande de l’aide pour que l’on m’apporte Baloo et mon téléphone. Tant que je suis encore un peu lucide et en état, il faut que je donne des nouvelles. Certes, « Marsouin » et « Colibri » ont été informés par l’hôpital que je vais bien. Un « coucou » en direct les apaisera. Alors j’appelle. Pour la première fois, je me rends compte que ma voix n’est pas comme d’habitude. On dirait qu’elle sort d’outre-tombe, rauque, faible… Normal j’ai été intubée. « Colibri » est d’ailleurs heureuse de m’entendre, car elle pensait que je ne pourrais pas parler. Ça non plus, je n’y avais jamais réfléchi.
Je ne peux pas me mouvoir sans hurler à la mort. Au moins, je vais pouvoir discuter. Mais tenir le téléphone m’est extrêmement pénible et inconfortable. Toute action m’épuise à une vitesse impressionnante. Alors, aussi rapidement que possible, je laisse des messages vocaux à mon cercle rapproché. J’espère qu’ils ne prêteront pas attention à mon élocution anormale et effrayante, car mon « Tout va bien » est en totale opposition avec les sons qui sortent de ma bouche. Je n’ai pas le temps de me préoccuper de cela. Tel le tonnerre, la souffrance gronde, les éclairs avant une nouvelle tempête ravageuse approchent à grands pas… Il me faut encore une dose de morphine en urgence. Mais, mes infirmières veulent que je mange avant.
Face à cette tâche usuelle pour un adulte, ma dignité se prend une nouvelle raclée ! Là encore, je me rends compte d’une dépendance. Je suis incapable de tenir une fourchette et encore moins de me nourrir en toute autonomie. Alors, l’aide-soignante me prépare de petites bouchées et me donne la becquée. Je n’avais déjà pas faim, cette épreuve me met définitivement KO et m’empêche d’avaler la moindre miette. Comme avec un bébé, elle me demande de fournir un effort, cinq cuillérées et j’aurai ma morphine. Je me sens honteuse d’être tel un nouveau-né qui pleure encore et toujours, d’être une junkie qui supplie pour sa dose. Je me force à ingurgiter la portion d’un moineau, mais si je continue je vais vomir.
Tout le monde est adorable, attentif, compréhensif avec moi et prend son temps. Chacun me dorlote ! Je n’ai jamais connu tant de prévenance dans un hôpital auparavant. Et pourtant, j’ai le sentiment d’être dans un cauchemar où à mon calvaire physique s’ajoute la torture psychologique d’être diminuée. J’ai l’impression de me disloquer au fur et à mesure que je tombe dans un gouffre sans fin !
Je veux capituler grâce à la morphine. Je n’aurai plus mal. Je ne me rendrai plus compte de rien. Je serai dans un monde sans rêve, sans couleur, sans saveur, que j’imagine proche du coma… et c’est tout ce que je désire !
Mon mal-être et mon malheur s’expriment par tous les pores de ma peau et chacun de mes gestes. Voyant que je suis à bout, l’aide-soignante n’insiste pas et appelle l’infirmière. Je vais avoir mon shoot. Dans quelques minutes, tout disparaitra. Enfin !
Ma première nuit est morcelée. Toutes les deux heures, les infirmières me demandent mon nom et ma date de naissance avant de vérifier mes constantes, changer mes perfusions, me remettre sous oxygène ou me donner une nouvelle dose de ma nouvelle meilleure amie : Morphine.
À mon réveil, je sens que j’ai un peu plus d’énergie. Vais-je retrouver un peu d’autonomie ? Confiante, j’essaie de lever une jambe. Est-ce que l’on m’a attachée à mon lit ? Est-ce que l’on m’a fixé des chaines avec des poids de 50 kg autour des chevilles ? Mes guiboles semblent s’être transformées en des bâtons de bois. Je ne réussis pas vraiment à les soulever ni même à les plier. Mon auto-déclaration d’indépendance n’est pas pour aujourd’hui. Comme pour attester de mon avilissement, deux aides-soignantes arrivent pour m’aider à me laver. Elles me demandent si je peux aller à la salle de bain. Des larmes plein les yeux, je leur réponds que je ne peux pas bouger.
Alors, elles s’approchent de moi. Ce sont elles qui vont me nettoyer, me brosser les dents, me coiffer… Si j’étais déjà en enfer, là je connais le tréfonds des abysses. J’ai envie de leur crier : « Oui, je suis sale et je pue de la gueule, ce n’est pas grave. Mimi cracra, c’est moi, je l’assume. Laissez-moi baigner dans mon jus pestilentiel ou crever ! ». Mais, il n’en est rien. Aucun son ne sort de ma bouche en dehors de « Merci ».
Avec une douceur infinie, elles me savonnent, me rincent, me lotionnent chacun de mes membres, chaque partie de mon corps même les plus intimes. Elles me font changer de position à deux et me tiennent tout le temps pour que je ne bascule pas. Le contraste entre la légèreté, la simplicité et la bonté avec laquelle elles prennent soin de moi et ma perception est saisissant. Pour moi, je suis un pantin désarticulé. J’ai le sentiment d’être frotté au papier de verre. Chaque mouvement est un coup de canif dans ma dignité, mon ego, mon intimité. Ma pudeur n’a pas de place non plus ici. Je ne peux retenir les flots qui baignent mes yeux et en même temps je m’en veux. Je sais à quel point ces deux femmes sont compréhensives, compatissantes, et tout cela sans aucun jugement ou évaluation. Elles sont à mes côtés, elles tentent de soulager mes souffrances et je me sens ingrate. Je souhaiterais tellement être ailleurs, disparaitre. Tout le temps où elles me rendent humaine, j’essaie de m’évader de mon corps en partant loin, très loin, dans un monde parallèle où tout cela n’existe pas.
Quand enfin le putois que j’étais s’est évaporé, elles cherchent à me nourrir. Malgré les techniques utilisées pour un nourrisson afin de m’alimenter et l’appel à ma conscience d’adulte pour que je me force, je n’arrive qu’à picorer quelques morceaux de pastèque. Craignant une possible dénutrition si cette situation perdure, défile alors des infirmières avec de nouvelles perfusions, un nutritionniste avec des produits liquides ultra-protéinés et mon chirurgien. Une fois que tout cela est terminé, je suis épuisée et j’ai mal.
Je demande ma dose. Ils acceptent. Je sombre. Bonheur !
À mon réveil, j’ai perdu la notion du temps : combien de temps ai-je dormi ? Quel jour sommes-nous ? Ça fait combien de temps que je suis là sans bouger ? Chaque seconde me parait durer des heures, des jours, une éternité… Et une seule pensée tambourine : je suis pour l’euthanasie !
J’ai toujours été favorable à cette pratique, médicalement assistée, pour les personnes en pleine possession de leurs « moyens » qui le désirent explicitement et à une loi qui l’encadrerait. Ce sujet fait débat aujourd’hui, mais cette expérience me conforte dans cette idée et celle de la fin de vie en toute dignité. On n’est jamais préparé pour être impotent, dépendant, à un retour à l’état régressif du nourrisson, et ce quel que soit l’âge.
Bien évidemment, dans mon cas, je sais rationnellement que cela ne durera pas. Mais pour celui qui a vécu toute son existence autonome et libre, se voir diminué chaque jour un peu plus jusqu’à une mort inéluctable, n’a vraiment rien de réjouissant. C’est pour les proches que le passage à l’acte est douloureux. Mais pour celui qui est dans ce lit, dans une condition où il n’est plus que l’ombre de lui-même, traité comme un nouveau-né à qui on met des couches, et que l’on alimente de nourriture insipide, la fin semble parfois plus douce et apaisante que continuer à vivre.
Cette pensée m’obsède, car j’ai perdu toute ma dignité. Brutale prise de conscience de n’être qu’une humaine. Sans tous les drapés d’éducation, de classe, d’espèce soi-disant supérieure, de nationalité, de statut social …, je perçois avec violence toute ma fragilité, mon impuissance, ma mortalité… Nous sommes tous égaux dans ce cas-là ! Il n’y a aucune différence !
Dans cet état de lucidité intense, mon optimisme demeure très ancré !
- J’ai de la chance ! Je suis en vie.
- J’ai de la chance ! Chaque seconde dure une éternité de douleur, mais tout ceci n’est que temporaire.
- J’ai de la chance ! Je suis en Thaïlande, le pays du sourire ! Le personnel est aux petits soins. L’équipe est nombreuse. Chacun a et prend du temps pour moi pour me réconforter, pour m’accompagner afin que je surmonte chaque épreuve, est attentif à chaque détail. Quand j’entends l’état de l’hôpital en France, je n’ai évidemment aucun regret d’avoir choisi d’être là !
- Je suis heureuse d’être seule ! C’est beaucoup plus facile d’être à nu vis-à-vis de parfaits étrangers que face à mes proches. J’accueille ce temps qui est le mien sans devoir être quelqu’un d’autre que moi, sans avoir à prendre un tiers en considération. Même si je n’aime pas cet état, j’accepte d’être sans fard devant tant de bienveillance d’inconnus.
- J’ai de la chance, à 40 ans passés, je suis entourée de personnes qui m’aident à me donner naissance et à réapprendre le goût des choses.
Cependant, la souffrance terrasse la lucidité. Alors, comme à chaque fois, j’appuie frénétiquement sur le bouton pour avoir une nouvelle dose de ma copine Morphine. Une fois reçue, je m’enfonce avec joie dans un univers cotonneux ou plus rien n’a d’emprise.
Le troisième jour de mon hospitalisation est identique au précédent. Pourtant je le vis mieux. La chute vers les tréfonds s’est arrêtée. Il n’y a plus de pire, car il n’y a plus de surprises avilissantes… Je suis toujours dans un état comateux. Je ne peux toujours pas à me lever. J’appuie toujours comme une junkie sur la sonnette d’urgence pour avoir ma dose… Mais, j’arrive à mieux gérer chaque situation. Elles me sont toujours aussi désagréables, mais je m’habitue à être cette version limitée de moi-même. En même temps, je n’ai pas d’autre choix que d’accepter la condition de dépendance qui est la mienne. Alors ma honte s’amenuise même si j’aimerais pouvoir me cacher dans un trou de souris. À défaut, je me réfugie dans une caverne interne. J’essaie de vivre chaque situation en étant extérieure à moi-même. Je me laisse bercer par mes envies de silence, de film, de rien. Je n’ai de comptes à rendre à personne, je ne vois personne et cela me soulage.
Le quatrième jour est un jour de bascule. Lors de la seconde séance de la journée de physiothérapie et grâce à mes kinésithérapeutes, j’arrive à me lever ! À l’aide d’un déambulateur, encadrée et harnachée de deux ceintures reliées à deux thérapeutes afin qu’ils puissent me tenir/me soutenir si je tombe, je marche ! J’effectue un aller-retour entre mon lit et la porte de la chambre. Distance totale : 25 mètres. Durée de l’expédition : 20 minutes. Chacun de mes pas n’est pas très assuré. Je redécouvre à l’âge adulte comment me déplacer. Évidemment, mon corps se souvient. Cependant, c’est saisissant d’apprécier chaque mouvement que l’on tenait pour acquis avec un nouveau regard, de nouvelles sensations.
Je suis debout ! Je marche ! Vous ne pouvez imaginer la joie immense que j’éprouve à cet instant.
Faire quelques pas est le symbole que les choses vont aller en s’améliorant, que je vais retrouver mon autonomie, ma dignité. Même si cela me fatigue, je veux continuer à avancer. Peut-être que je peux pousser jusque dans le couloir ?
En revanche, je demande à me débarrasser du déambulateur. Bien que la position soit la plus haute possible, il n’est pas à ma taille. L’utiliser m’oblige à me plier en deux. C’est plus handicapant qu’autre chose, car je ne fais pas 1m60. Avec mon mètre quatre-vingt, ce n’est pas adapté. Alors mes deux kinés, faisant tous les deux une tête de moins que moi, se regardent et évaluent la faisabilité et ma sécurité. Toujours maintenue à chacun deux par une sorte de harnais, ils acceptent. C’est une délivrance ! Je me sens plus à l’aise, plus assurée dans chacun de mes pas. Je retrouve de la force dans mes jambes. Avançant, droite comme un I, je ressens toute la puissance de ma détermination et de ma rage de vivre. Je suis maintenant convaincue que le plus dur est derrière moi.
Fière, mais épuisée par mon exploit, je retourne m’allonger. Mes kinés me félicitent : « Demain, on fait 100 mètres ! ». Je souris pleine de gratitude face à ce nouveau défi tout en demandant mon shoot de morphine. Sur ces entrefaites, mon chirurgien arrive. Il est heureux de voir mes progrès. Il définit le plan de rééducation avec mes thérapeutes pour les 48 heures à venir. En revanche, il m’informe qu’il est temps de me sevrer de ma meilleure copine morphine. Cela fait déjà quatre jours que j’en prends quotidiennement plusieurs doses. Il ne faut pas que cela dure. Le risque de dépendance s’accroit de jour en jour. De plus, il s’inquiète. Je mange peu voire trop peu. Il pense que mon manque d’appétit est potentiellement un effet secondaire. Il est urgent d’enrayer cela, car je suis, pour lui, « trop skinny ». J’essaie de le rassurer. Je ne suis pas anorexique. Je ne cherche pas à maigrir. Je n’ai juste pas faim. Tel un père prenant soin de son enfant, il me sourit. Il me donne son accord pour un dernier « fix » pour que je dorme sans douleur, mais après c’est fini !
Pour la première fois, je ne suis pas réveillée toutes les deux heures pour vérifier que tout va bien. L’unique contrainte, c’est que je n’ai pas le droit de me lever toute seule notamment pour aller à la salle de bain. Le risque de chute reste élevé. Je dois donc être accompagnée en permanence, mais je suis, malgré cela, indépendante.
Le lendemain matin, c’est avec joie que j’informe les aides-soignantes que j’ai l’impression d’être capable de me laver comme une grande. Elles vérifient que j’ai bien l’autorisation d’aller prendre une douche, changent mon pansement pour que mes cicatrices soient bien protégées et en avant. Évidemment, je ne peux être seule, mais rien que le fait de me tenir debout, de sentir l’eau qui jaillit sur ma peau… est un véritable enchantement. Cela me rappelle la première douche chaude que j’ai prise au Vietnam après plus de 3 semaines d’eau glacée pendant la saison des typhons. Ce bonheur est simple, fondamental, existentiel ! C’est étonnant ! Il suffit d’être privé quelque temps d’un de nos besoins primaires pour que tout d’un coup lorsqu’il est de nouveau accessible, on perçoive sa valeur inestimable.
Je savoure donc ce moment tout en me rendant compte que je suis heureuse de ne pas être seule. Je n’arrive pas à faire certains mouvements : me courber, lever les bras pour me laver les cheveux… Alors, c’est avec beaucoup de gratitude que je demande à mon aide-soignante de m’assister. Elle a toujours la même bienveillance que la première fois, la même douceur… mais cette fois-ci, je les ressens. Je suis touchée aux larmes par tant de bonté, de simplicité. Je suis impressionnée par ces femmes qui prenant en compte la pudeur de leurs semblables leur rendent leur dignité et leur image. Et dire que j’étais incapable de le percevoir il y a quatre jours.
Comme je peux me lever, mon infirmière me débranche de toutes les machines et j’ai le droit de changer de tunique. Fini la blouse où on se « balade » cul nu… À moi le superbe pyjama 😊. Et ça tombe bien, car avec mon kiné, j’ai pu effectuer deux allers-retours dans le couloir de mon étage, allant d’une extrémité à l’autre du bâtiment, soit environ 200 mètres chacun. Le premier, j’ai marché en étant attachée à lui grâce au « harnais » et le second juste en lui tenant la main. Tous ces signes me ravissent ! Tout prouve que ça va de mieux en mieux et que cela peut aller vite. Hier, je déambulais 25 mètres aujourd’hui 400… Bientôt, je pourrai courir, sauter, grimper…
Aussi quand je vois le Dr S. dans l’après-midi, je suis heureuse de lui faire part de mes prouesses du jour. La cicatrisation se passe bien et j’ai pu marcher 400 mètres ! Demeurent pourtant quelques préoccupations. Mon niveau de douleur reste très élevé malgré le tramadol. Ce médicament à base d’opioïdes n’est pas de la morphine, mais ce n’est clairement pas une pastille Vichy. Il suppose que mes efforts ne sont pas suffisamment progressifs, que j’en fais trop et que ma musculature est celle d’un marshmallow. En plus, je mange toujours très peu et j’ai des problèmes de transit. Compte tenu de cela et sachant qu’après je serai seule, il souhaite décaler ma sortie de l’hôpital d’un ou deux jours. N’étant pas à 24 ou 48 heures près, cela me va bien de rester dans le cadre protecteur et bienveillant de Bumrungrad. Maintenant que je peux me lever et marcher, je vois les choses d’une façon différente, beaucoup plus tranquille.
Il faut donc traiter un problème après l’autre. Malgré le choix des menus proposés, rien ne me fait envie en dehors des fruits. Alors, je m’engage à prendre les boissons ultra-protéinées plusieurs fois par jour. Cela compensera le fait que je ne mange pas. Par ailleurs, on me donne des médicaments afin que j’aille à la selle rapidement.
Quelques heures après, des brûlures terribles me vrillent le ventre. J’appuie donc comme une dingue sur la sonnette d’urgence pour que l’on m’accompagne pour aller aux toilettes. Malgré mes prouesses de l’après-midi, je ne me sens pas capable de faire les 15 pas qui me séparent de la salle de bain toute seule. Une fois sur le trône, rien ne se passe. En revanche, la douleur se fait de plus en plus violente, incontrôlable. Je suis assise et paralysée. Chaque micromouvement me transperce. Malgré ma vision rendue floue par mes larmes et ma souffrance, je vois le macaron « Emergency ». J’actionne l’alarme, mais cela ne fonctionne pas. Pas de son, pas de lumière. Je réessaie, encore et encore… Rien. Alors, je crie, suppliant « Is anybody there? Please help me » !!! Je veux m’allonger sur le carrelage et crever ! Mais, je ne peux bouger, je reste là à hurler ! Ma seule pensée va à ce titre « On achève bien les chevaux ! »
Après un temps qui me parait infini, mais qui probablement ne dure pas plus de 3 ou 4 minutes, débarque une aide-soignante. En quelques secondes, elle est rejointe d’infirmières et de brancardiers. Je supplie que l’on me mette à terre. Ils refusent. Je sais bien que si je suis par terre, je serai ensuite un âne mort pesant une tonne. Mais, de mon point de vue, c’est la seule option envisageable. Rester sur le sol froid et attendre la mort.
Évidemment, je suis à l’hôpital, c’est impossible de laisser les gens crever ainsi. Ils veulent me basculer sur un fauteuil roulant pour me ramener dans mon lit. Cet effort me semble irréalisable. Comment ont-ils fait ? Combien de temps cela a pris ? Je me souviens juste d’avoir été encadrée par quatre ou cinq personnes. Une fois allongée, tout en me tenant la main et cherchant à me réconforter, mes anges d’aides-soignantes et d’infirmières m’ont lavée, changée et donnée de la morphine.
Au réveil du sixième jour, j’ai l’impression que l’on m’a roulé dessus. Je suis contusionnée, j’ai mal partout et j’ai peur. L’épisode de la nuit dernière m’a tellement traumatisé que je décide de ne pas en parler. J’ai perdu toute ma témérité. Quand on m’a dit que je marcherai en sortant de l’hôpital, je croyais que ce serait une simple illustration de « lève-toi et marche ». Quelle utopie ! Quelle naïveté ! Heureusement, l’équipe médicale est présente à mes côtés. Personne n’évoque les évènements de la veille. Mais je vois bien par chacun de leur geste qu’ils me poussent à reprendre confiance pour m’assoir, me lever, me rendre à la salle de bain, me laver, marcher. Ils me transmettent leur force, leur foi. Chaque sourire, chaque regard est un encouragement visant à normaliser ce qui se passe avec les hauts et les bas de la convalescence. Je croyais que ma guérison serait linéaire et ascendante, que jamais il n’y aurait de retour en arrière, de chutes, de nouvelles difficultés. Quel orgueil !
Avec plus d’humilité, je reprends la marche dans le couloir et je bois les potions données par le nutritionniste. J’arrive même à me balader toute seule dans le jardin de l’hôpital. Normalement, je sortirai de Bumrungrad demain sur mes deux pieds, mais les road trip, la liberté… ce n’est pas pour tout de suite. C’est alors que Baloo, dans ma main à chaque pas, m’engueule ! Souviens-toi qu’il en faut peu… Saisie par cette injonction, je perçois le ciel bleu, je sens le soleil sur ma peau, j’entends les oiseaux, le tumulte de la ville… C’est un appel à la vie.